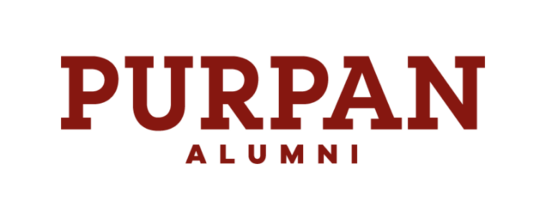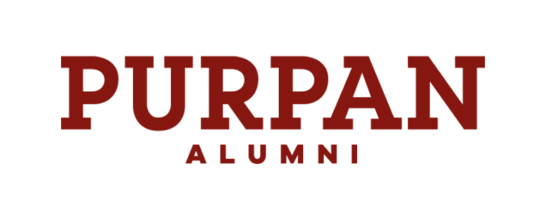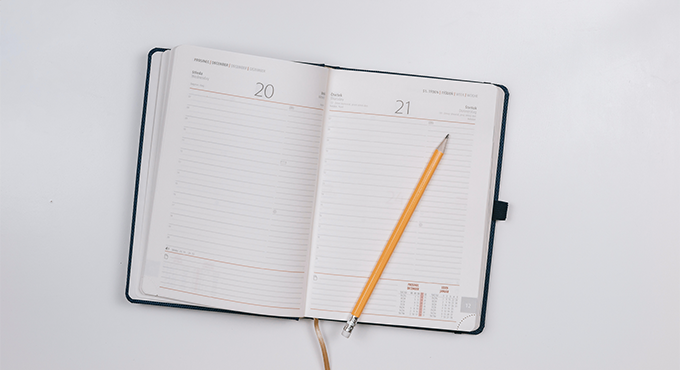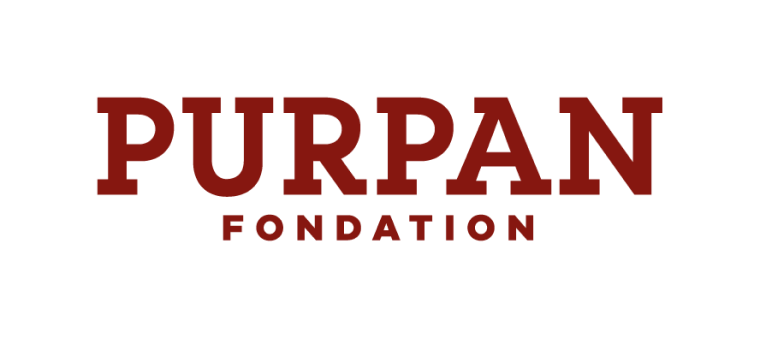Actualités

Portrait de Marielle PAGES (91e) - Enseignante chercheuse à PURPAN et membre du Conseil d'Administration de PURPAN alumni
20 mars 2023
Portraits d’Alumni
Vue 906 fois
#1 Tu es entrée à PURPAN en promo 91, quel est ton meilleur souvenir de tes années en tant qu’étudiante ? Parle-nous de ton parcours : de ton arrivée à l’école de PURPAN à aujourd’hui !
Je devrai...
Il faut être connecté pour lire la suite